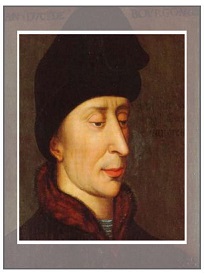|
Histoire |
Accueil |
Commentaires |
Famille |
Généalogie |
 |
|
Histoire commune de la Bourgogne et de la Franche-Comté |
||
|
L’union sous les Capétiens En 1330, Jeanne II de France (1330-1347) comtesse de Bourgogne et d'Artois, fille aînée de Philippe V et de Jeanne Ière de Bourgogne, apporte en dot ses terres à son mari Eudes IV duc de Bourgogne (1315-1349). Cette succession ne se fait sans heurts, car ses deux autres sœurs, Marguerite de France et Isabelle de France, se sentent lésées et s’insurgent. Elles trouvent du soutien dans la noblesse comtoise. Mais suite à l’intervention médiatrice du roi Philippe VI, qui augmente l’apanage des deux princesses, le calme revient. Les deux Bourgognes se trouvent réunies après quatre cents ans de séparation. Eudes fonde le Parlement de Dole le 09 février 1332, la plus haute institution judiciaire du comté de Bourgogne. Le gouvernement dur d'Eudes, sa volonté de dominer le comté en imposant un bailli, en blessant dans leur orgueil les nobles, dressent ces derniers contre le duc-comte. à l’investigation de Jean II de Chalon-Arlay (1322-1362) à trois reprises (1335-1337, 1342-1343 et 1346-1348) des soulèvements seigneuriaux rompent la paix relative qui existe depuis le début du siècle et amènent le malheur. En avril 1336, Jean II de Chalon-Arlay, fort du soutien de Henri de Montbéliard, Thiébaud de Neufchâtel et des Bisontins, déclare la guerre. Ses troupes brûlent Salins et Pontarlier. Eudes IV rassemble les siennes et marche sur les ligueurs; la rencontre a lieu entre Besançon et Avanne, où mille bisontins périssent. La médiation de l’archevêque de Besançon, Hugues de Vienne arrête le conflit. Depuis ce temps, le lieu-dit de cette bataille s’appelle la Malecombe pour rappeler ce terrible événement. Le conflit reprend à l’hiver 1337, mais la médiation du roi de France met un terme au combat. Les chefs des révoltés sont emprisonnés. Jean II est emmené en prison à Montréal en Auxois, il y reste un an. Le sceau d'Eudes IV
Le fils de Eudes IV et de Jeanne II, Philippe épouse en 1338 la comtesse de Boulogne et d'Auvergne Jeanne Ière, l’état bourguignon s’amorce. La guerre civile reprend en 1342, car Jean II humilié par son emprisonnement, et refusant de détruire sa forteresse de Salins, et Eudes IV n’oubliant pas l’incendie de Salins, les braises du conflit de 1336 ne sont pas éteintes. Les hommes du duc-comte s’emparent du château de Châtelguyon, appartenant au sire d'Arlay. Ce dernier se réfugie dans le Haut-Doubs pour poursuivre la lutte. Eudes s’en prend à Thiébaud de Neufchâtel, qui vaincu, implore la paix. Par sa mère, Jean II de Chalon-Arlay, descend des Dauphins de Viennois. Il décide en 1344 de passer un accord avec son cousin Humbert II, en lui remettant les terres qu’il possède dans le Dauphiné, peut-être pour payer ses efforts de guerre. En 1346, la défaite des Français à Crécy en août, prive Eudes du soutien du roi. Puis le malheur frappe la famille ducale, Philippe est tué au siège d'Aiguillon, en septembre, où il combat dans l’armée française. Jean II en profite pour former une nouvelle ligue. Il demande l’appui financier des Anglais et l’obtient en octobre. Les escarmouches sont nombreuses, mais aucune bataille n’est décisive. Eudes s’absente de la Comté pour aller prêter main forte au roi au siège de Calais. La guerre épuise matériellement les belligérants et sur l’arbitrage du roi un traité de paix est signé à l’automne 1347. Eudes doit restituer ses dernières conquêtes, Jean de Chalon rebâtit Châtelguyon, il ressort comme vainqueur de ce conflit. Mais un malheur ne venant jamais seul, la peste noire frappe l’ensemble de la Bourgogne entre 1346 et 1349, des villages entiers sont dépeuplés, des villes perdent les trois quarts de leurs populations. La mort de Eudes en 1349, due à la peste noire, amène son petit-fils Philippe de Rouvres (1349-1361) enfant maladif à la succession de cet immense territoire. C’est sa mère Jeanne de Boulogne qui exerce la régence. Cette même année, Humbert II ruiné, vend le Dauphiné au roi de France. Jean de Chalon-Arlay se sent lésé et se considère l’héritier de cette principauté. Toutefois il donne son accord et signe cette transaction en renonçant à ses droits. En 1350, Jeanne de Boulogne se remarie avec Jean, fils du roi de France Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne, la sœur de Eudes IV. Jean prend le titre de régent de Bourgogne. La même année, Jean devient Jean II roi de France, et gouverne le duché et le comté de Bourgogne. Jean prévoit que Philippe de Rouvres mourra jeune et envisage de mettre la main sur ses domaines. Jean II de Chalon-Arlay combat les Anglais en Guyenne dans l’année 1352. En 1356, c’est la défaite de Poitiers contre les Anglais, le roi Jean II est fait prisonnier et emmené en Angleterre. Jeanne de Boulogne assure la régence du royaume. En 1357, le mariage de Philippe de Rouvres avec sa cousine Marguerite de Flandre, fille du comte de Flandre, de Nevers et de Rethel, Louis II de Mâle (1346-1382) est conclut. La bataille de Poitiers
Le malheur survient à nouveau, Philippe meurt d’une chute de cheval en 1361 dans la cour de son château de Rouvres, avec lui s’éteint la dynastie des ducs de Bourgogne issus d’Hugues Capet. La séparation temporaire La disparition prématurée à l’âge de dix-sept ans de Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, d’Artois, d'Auvergne et de Boulogne, amène une séparation temporaire du duché et du comté. Le roi de France Jean II le Bon déclare que le duché lui revient à titre héréditaire, les comtés de Bourgogne et d'Artois sont légués à Marguerite de France (1361-1382), fille cadette de Philippe V et de Jeanne Ière de Bourgogne, veuve du comte de Flandre, de Rethel et de Nevers Louis Ier. Les comtés de Boulogne et d'Auvergne vont à Jean de Boulogne, oncle de la mère de Philippe de Rouvres. Le roi fait son entrée triomphale dans la capitale du duché le 23 décembre 1361, et inaugure un cérémonial qui sera repris par la suite en prêtant serment dans l’église Saint-Bénigne de maintenir les privilèges de la ville et recevant en retour les serments de fidélité et de loyauté de la commune. Quelques jours plus tard, il convoque les États de Bourgogne auxquels il renouvelle les droits et privilèges. Dans la comté, Marguerite se heurte à un prétendant au titre de comte palatin, il s’agit de Jean de Chalon, sire de Montaigu. Il est par son père l’arrière-petit-fils du comte Hugues de Chalon. Il s’empare d'Apremont, de Gray et de Jussey, mais il est battu et doit renoncer à ses prétentions. Jean II de Chalon-Arlay meurt en 1362 de la peste noire. Marguerite hérite d’une province qui vient d’être frappée par la peste, à ces difficultés s’ajoute la convoitise du roi Jean II. En 1363, avant de retourner prisonnier en Angleterre, Jean II concède en apanage le duché de Bourgogne à son quatrième fils, Philippe (1363-1404), surnommé le Hardi depuis la bataille de Poitiers, avec le titre de premier pair du royaume. Philippe lorgne sur le comté, il a l’appui de quelques nobles comtois, Henri et Jean de Vienne et Jean et Louis de Chalon-Auxerre. Il enrôle « les Routiers », licenciés après le traité de Brétigny en 1360, regroupés en grandes compagnies qui sévissent dans son duché et les envoie ravager la Comté. La comtesse fait appel aux nobles comtois qui sous la direction de Henri de Montfaucon, comte de Montbéliard, se liguent contre les Routiers. Hugues et Louis de Chalon-Arlay, Etienne et Jean de Montfaucon, Philippe de Vienne et Thiébaud VII de Neufchâtel apportent leur soutien au comte de Montbéliard. De fin décembre 1363 à février 1364, les combats sont nombreux à la limite des deux provinces. Début mars 1364, le duc quitte la Comté et emmène une grande partie des Routiers combattrent le roi de Navarre qui s’est révolté contre le roi Charles V, frère de Philippe. Marguerite tente une médiation avec le roi, mais insatisfaite des termes du contrat, elle reprend le combat. Henri de Montbéliard convoque à Arbois le 09 juin, une assemblée des nobles qui décide de reprendre la lutte. L’invasion du duché se prépare, mais l’autre côté de la Saône, le seigneur de Sombernon, gouverneur de la Bourgogne, rassemble des hommes, bientôt rejoint par les troupes venant de Champagne sur l’ordre du roi. Les armées ducales sont plus nombreuses, Henri évite la bataille. Pendant ce temps, les négociations continuent à la cour de France, et le 25 juillet le traité de paix est signé. Il sera accepté par les barons comtois au mois d’août et septembre. La guerre est terminée, Marguerite triomphe. Le 6 novembre 1364, Philippe II fait son entrée solennelle à Dijon, accompagné du duc d'Anjou son frère, de l’évêque d'Autun, et de toute la noblesse bourguignonne. En 1364, Hugues II de Chalon-Arlay (1362-1388) obtient de l’empereur Germanique Charles IV, le titre de vicaire impérial et les droits que l’empire possède sur Besançon. La puissance de la famille des Chalon est au maximum. En 1366, le mot de «Franche-Comté» apparaît pour la première fois pour nommer le comté de Bourgogne. La même année, l’amiral Jean de Vienne bat près de Chambornay les Routiers qui ravagent la Franche-Comté et la Bourgogne. Tristan de Chalon-Auxerre, sire de Châtelbelin et de Rochefort, combat les Routiers qui se sont basés près de Chalon-sur-Saône. La victoire n’est pas décisive, il faut de l’argent pour les obliger à quitter la province, c’est le connétable Bertrand du Guesclin qui négocie à Chagny la somme de 200 000 livres avec les mercenaires en les envoyant combattre en Espagne. En 1369, Philippe le Hardi épouse Marguerite de Flandre, la veuve de Philippe Ier de Rouvres, la fille de Louis de Mâle, ce dernier est le fils de Marguerite de France. De longues négociations sont nécessaires à la conclusion d’une telle alliance, car Marguerite de Flandre est l’héritière par son père des comtés de Flandre, de Rethel et de Nevers et par sa grand-mère paternelle, des comtés de Bourgogne et d'Artois. Le roi Charles V, frère de Philippe, verse la somme de 200 000 livres tournois à Louis de Mâle en compensation de cet accord de mariage. Hugues II de Chalon-Arlay combat avec Du Guesclin les Anglais, il participe au siège d’Arches en 1377. En 1378, Philippe rétablit l’atelier monétaire d'Auxonne, en terre d’empire, et frappe sa propre monnaie pour montrer son signe d’indépendance vis à vis du royaume de France. Philippe le Hardi
Louis ne viendra jamais en comté, il meurt en 1384, sa fille Marguerite de Flandre hérite de ses terres. Philippe doit de nouveau engager la lutte contre les Gantois qui sont toujours insoumis et une troisième intervention en 1385, permet enfin de ratifier un traité de paix à Courtrai. La guerre des Flandres est terminée. L’union sous les Valois et l’expansion Marguerite de Flandre (1384-1405) apporte à son mari Philippe le Hardi, ces cinq comtés. Philippe devient ainsi le prince le plus puissant de la chrétienté. Il attire en Bourgogne des artistes flamands et commence l’édification de somptueux monuments. Cette même année, Philippe et Marguerite dotent leur fils Jean du comté de Nevers et de la baronnie de Donzy. En 1385, Philippe marie son fils Jean de Nevers à Marguerite de Bavière; et sa fille Marguerite de Bourgogne à Guillaume de Bavière, les deux enfants de Albert de Bavière. Ce dernier est comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Marguerite de Bavière apporte 200 000 écus en dot. Les noces sont célébrées à Cambrai avec une magnificence jamais vue, tous les grands de France, de Bourgogne, de Flandre, de Hainaut, de Hollande et du Brabant sont présents. Philippe s’offre des perspectives d’expansion avec le mariage de ses deux enfants avec ceux de la famille des Wittelsbach de Bavière. Cette même année, le duc organise les institutions de ses principautés, il crée un office de « chancelier de monsieur le duc », dont le titulaire devient le garde des sceaux du duc et le chef de l’administration de l’ensemble des états du prince. En 1386, une Chambre du conseil et des comptes est instaurée et réside à Lille. Philippe fixe le siège du Parlement comtois à Dole, qui avec sa Chambre de justice, juge en appel, consacre le pouvoir de la bourgeoisie toute dévouée au duc comte. Le duc met également en place une Chambre du conseil et des comptes à Dijon pour la Bourgogne. Le duc-comte choisit l’église de la chartreuse de Champmol, aux portes de Dijon, comme lieu de sépulture familiale. Marguerite de Flandre
En 1387, Philippe obtient du roi Charles VI la conservation des châtellenies de Douai, Lilles et Orchies. En 1390, Philippe achète le comté de Charolais pour 60 000 écus d’or à Bernard VII d'Armagnac, avec l’argent de la dot de sa bru Marguerite de Bavière, l’expansion bourguignonne continue. C’est le retour de ces terres dans la Maison de Bourgogne, rappelons qu’elles faisaient parties du comté de Chalon-sur-Saône depuis le Xème siècle, puis intégrées dans le duché au XIIIème siècle. Toujours en 1390, Jean III de Chalon-Arlay (1388-1418), abrite dans son château de Jougne les assassins d’un sergent de Philippe le Hardi. Ce dernier le fait citer devant le Parlement de Dole. Jean III s’enfuit à Paris, il est arrêté en 1391, et conduit à Vantoux près de Dijon. Philippe l’écrase de sa magnanimité en l’autorisant à rejoindre son château de Chalamont, puis celui de Nozeroy en 1392. Puis l’année suivante le duc-comte lui accorde la grâce. En 1392, Philippe continue sa politique d’alliance matrimoniale, en mariant sa fille Catherine avec le futur duc d’Autriche, Léopold IV de Habsbourg. La régence du royaume En 1393, en raison de la folie du roi de France Charles VI, Philippe a la charge de la politique générale du royaume; mais dans ses périodes de lucidité, Charles VI s’appuie sur son frère le duc d'Orléans Louis. Les deux princes s’affrontent, se haïssent et passent leur temps à mettre à néant les décisions de l’autre. En 1396, à l’appel du roi de Hongrie Sigismond, en lutte contre les Turcs ottomans, les seigneurs français répondent présents. L’armée française est dirigée par Jean, comte de Nevers. Les Français arrivent en juillet en Hongrie où ils rejoignent les autres seigneurs Anglais et Hongrois. Mais les chrétiens subissent une terrible défaite à la bataille de Nicopolis le 25 septembre, contre les Turcs du sultan Bajazet. De nombreux nobles sont tués dont l’amiral Jean de Vienne, Guillaume de Vergy, Jacques de Vergy, Guillaume de la Trémoille, Jean de Chalon-Auxerre, sire de Châtelbelin, et le fils du comte de Montbéliard Henri de Montfaucon. La mort de l’héritier mâle du comté de Montbéliard, Henri de Montfaucon, à Nicopolis, va conduire ce comté dans une famille germanique, suite au mariage de Henriette l’héritière avec le comte Eberhard IV de Wurtemberg, jusqu’à la Révolution Française. Le comte de Nevers et vingt-deux autres seigneurs sont faits prisonniers par les Turcs, et il faut une énorme rançon de 300 000 écus pour les racheter. Ils prennent le chemin de retour par la mer, durant le trajet meurt Guy de la Trémoille, grand chambellan de Bourgogne. Malgré cette défaite, les survivants sont accueillis en héros, et Jean se voit surnommer « Jean sans Peur ». Pour payer son luxe exagéré et ses campagnes militaires, Philippe écrase son peuple d’impôts, notamment en établissant la gabelle dans ses États. En 1398, l’empereur Germanique Wenceslas accorde des privilèges aux Bisontins dans le domaine judiciaire. L’indépendance de la Commune de Besançon n’a jamais été aussi grande. Pour mieux manifester son attachement à son duché et son comté, Philippe fait confectionner en 1398 un anneau que l’abbé de Saint-Bénigne de Dijon doit passer au doigt de chaque nouveau duc. Philippe le Hardi a la cour la plus fastueuse d'Europe, dont le luxe et les dépenses coûtèrent gros à la Bourgogne. En 1401, le duc poursuit sa politique matrimoniale, il marie sa fille Marie de Bourgogne avec le comte de Savoie Amédée VIII. L’année suivante, Philippe est en Flandre pour marier son fils Antoine, avec Jeanne de Luxembourg, la fille et héritière du comte de Ligny et de Saint-Pol, Waleran de Luxembourg. Le duc et la duchesse accordent le comté de Rethel à Antoine. Le duc d'Orléans profite de l’absence du duc de Bourgogne, pour se faire nommer président du conseil par le roi et s’empare du trésor du royaume pour ses propres dépenses. Le duc de Bourgogne accourt à toute hâte, et le roi lui attribue le gouvernement entier du royaume. Orléans incapable de soutenir une guerre civile, se voit forcé de quitter les affaires, mais il conserve le trésor volé. En 1404, le duc de Bourgogne se rend en Flandre pour faire reconnaître son fils Antoine, comme l’héritier par sa mère, des duchés de Brabant et de Limbourg, au décès de la duchesse Jeanne de Brabant, tante de sa mère. À Bruxelles, il attrape la peste, qui l’emporte en quelques jours. Il meurt cribler de dettes. Sa veuve est obligée de renoncer à la communauté des biens, pour sauver son douaire des créanciers, et selon le rituel en Bourgogne elle dépose sur le cercueil, ses clefs, sa bourse et sa ceinture. Son corps est transporté à la chartreuse de Champmol de Dijon, qu’il a fait construire, où est édifié un superbe tombeau en marbre. La succession de Philippe le Hardi Les terres de Philippe sont réparties entre ses trois fils, l’aîné Jean sans Peur (1404-1419), comte de Nevers depuis 1384, reçoit le duché de Bourgogne et les comtés de Bourgogne, d'Artois et de Flandre, le second Antoine (1404-1415) qui est comte de Rethel depuis 1402, héritera des duchés de Limbourg et de Brabant en 1406, et le troisième Philippe (1404-1415) hérite des comtés de Nevers et de Rethel et de la baronnie de Donzy, cédés par ses deux frères. Jean poursuit la lutte contre son cousin Louis d’Orléans. Celui-ci s’est empressé de s’emparer du pouvoir. Comme il a dépensé tout l’argent, il demande au conseil du roi de lever une taille sur tout le royaume. Jean s’oppose à cette décision, mais comme il est en minorité au conseil, il se retire dans ses terres. En 1405, le roi Charles VI dans un moment de lucidité, réunit le conseil pour trouver une solution sur la triste situation du royaume. Jean a décidé de retrouver sa prééminence à la Cour par la force, il se présente à Paris le 19 août, avec huit cents chevaliers, le duc d'Orléans s’enfuit avec la reine et le dauphin. Jean rattrape le dauphin et le ramène à Paris. Orléans réunit ses hommes et marche sur Paris, la guerre civile est imminente. Le duc de Bourgogne s’allie aux Parisiens, mais sous la médiation de leur oncle, le duc de Berry, les deux princes se réconcilient. Pendant ce temps, les Anglais poursuivent l’occupation de la France, ils sont en Guyenne, en Artois et en Picardie. La lutte contre les Armagnacs Le 4 novembre 1407, Jean fait assassiner son cousin Louis pour, selon ses dires « soulager la France de ce tyran », mais va se réfugier dans ses terres de Flandre, où il fait rédiger un texte justifiant son acte. Jean vient présenter devant Charles VI l’argumentation de son geste, et en mars 1408, par décision royale son crime est aboli. En novembre 1408, il fait une entrée triomphante dans Paris après sa victoire sur les bourgeois liégeois qui se sont soulevés contre son beau-frère l’évêque de Liège Jean de Bavière. La reine et les princes s’enfuient de la ville avec le roi. Tout rentre dans l’ordre lors du traité de Chartres en 1409, où le roi et les enfants de Louis d'Orléans accordent le pardon au duc de Bourgogne, et celui-ci obtient le pouvoir total du gouvernement, mais le conflit entre la famille de Bourgogne et celle d'Orléans reste latent. Jean sans Peur
En avril 1410, le fils de Louis d'Orléans, Charles, épouse Bonne, la fille du comte d'Armagnac Bernard VII, et la lutte va s’engager entre Bourguignons et Armagnacs. Le parti Armagnac composé des ducs d'Orléans, de Berry, de Bourbon, de Bretagne et des comtes d'Armagnac, de Clermont et d'Alençon, prend les armes dans l’été, mais une nouvelle fois, un accord est trouvé et signé. En janvier 1411, Jean s’empare du comté de Tonnerre, possession de Louis de Chalon, qui s’est rallié aux Armagnacs. La guerre civile éclate dans l’été. Jean fait appel aux Lorrains, aux Brabançons, aux Allemands et aux Parisiens, et notamment à la corporation des Bouchers. Rien de plus vain que cette guerre, rien de plus étrange, rien de plus tragique aussi car on massacre, on pille, on brûle. La France est déchirée en deux. Jean sans Peur oubliant qu’il est petit-fils d’un roi de France, sollicite même l’appui des Anglais. Les Anglais Les Armagnacs sollicitent à leur tour l’aide des Anglais. Jean sans Peur aidé des Anglais s’empare de Paris, mais la ville est reprise en 1413 par le comte d’Armagnac. Au printemps 1414, le roi et les Armagnacs, forts d’une armée de deux cent-mille hommes, se mettent en route, et se lancent contre Jean, ce dernier s’enferme dans Arras, secondé notamment par Jean de la Trémoille et Jean de Neufchâtel. Ils soutiennent le siège. Après plus d’in mois de siège, et grâce la médiation du duc de Brabant et du dauphin, un traité est signé, qui interdit à Jean de revenir auprès du roi ou du dauphin sans leur accord express. En 1415, Henri V roi d'Angleterre réclame la couronne de France, la guerre s’accentue entre les deux pays. Henri V débarque avec vingt-six mille hommes. C’est la bataille d'Azincourt et la défaite des français ou six mille barons, chevaliers, et l’élite de la chevalerie française périssent, dont Antoine de Brabant, Philippe de Nevers, les deux frères de Jean sans Peur, Jean IV de Chalon-Auxerre et Robert de Bonnay, bailli de Mâcon. Charles d'Orléans est emmené comme prisonnier en Angleterre, il y restera vingt-cinq ans. Après cette défaite, le comte d'Armagnac est nommé connétable du royaume, et fait régner la tyrannie sur les Parisiens. En 1416, le dauphin meurt, il est remplacé par son jeune frère Charles. Le premier acte de ce dernier est de dépouiller sa mère Isabelle de toute autorité et de l’envoyer en résidence surveillée à Tours. En 1417, Jean III de Chalon-Arlay épouse Marie de Baux, l’héritière de la principauté d’Orange. À compter de cette date, les sires d'Arlay portent le titre de prince d’Orange. En 1417, Jean sans Peur libère la reine Isabelle de sa résidence de Tours et l’installe à Troyes. Pendant ce temps, un complot à Paris, contre le connétable réussit avec le concours des partisans du duc de Bourgogne. Les massacres d'Armagnacs sont nombreux, presque trois mille personnes. Une épidémie survient et provoque la mort de cinquante mille personnes, dont le prince d'Orange Jean III de Chalon-Arlay, qui a accompagné en fidèle vassal le duc de Bourgogne. Jean et Isabelle font leur entrée dans Paris et rétablissent le calme. Pendant ce temps Henri V poursuit son avancée en France et en 1419, annexe la Normandie; il s’avance sur Paris. La Cour de France sous la conduite du duc part pour Troyes. En récompense de ses services, Isabelle donne la garde du Mâconnais au duc Jean. Jean nomme le bailli de Mâcon Girard de la Guiche pour le représenter dans le Mâconnais. Des rapprochements ont lieu entre le dauphin Charles, le futur Charles VII, et Jean sans Peur, pour lutter contre les Anglais; mais l’assassinat du duc lors de sa rencontre avec le dauphin, en septembre 1419, sur le pont à Montereau sur Yonne fait échouer l’alliance franco-bourguignonne. Ce crime est la vengeance de la mort du duc d'Orléans intervenue douze ans plus tôt. L’alliance anglo-bourguignonne Philippe III le Bon (1419-1467) succède à son père, et se rapproche de Henri V d'Angleterre, tandis que le dauphin se retire au-delà de la Loire. Par le traité de Troyes en 1420, Henri V se fait reconnaître l’héritier de Charles VI. Il fait son entrée dans Paris accompagné de Philippe le Bon et de Charles VI. Cette même année, les Armagnacs venus du Lyonnais reprennent le Mâconnais. Le 14 juin 1421, Louis de Chalon-Arlay (1418-1463), prince d'Orange, obtient de l’empereur le titre de vicaire impérial pour tout l’ancien royaume de Bourgogne. En octobre 1421, Philippe obtient du pape Martin V, l’autorisation d’ouvrir une Université en Franche-Comté soit à Dole soit à Gray. Philippe Le Bon
La guerre est terrible entre les anglo-bourguignons et les fidèles de Charles VII. Les défaites en 1423/1424 de Cravant et Verneuil laissent Charles VII et ses armées au-delà de la Loire. En Mâconnais, les Armagnacs occupent en 1423 la plupart des places fortes. En septembre les troupes anglo-bourguignonnes lancent une offensive et reprennent les forteresses. En juillet 1424, l’Université des deux Bourgognes s’ouvre à Dole. On y enseigne la théologie, les droits civil et canon, les arts et la médecine. L’héritage flamand Entre 1421/1428, Philippe le Bon est occupé à lutter contre sa cousine germaine, la comtesse de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Frise, Jacqueline de Bavière. Cette femme cruelle qui a épousé contre son gré son cousin, le duc de Brabant Jean, a fait assassiner les fidèles amis de son mari; en représailles celui-ci bannit les dames d’honneur de son épouse. Elle se réfugie en Angleterre, obtient le divorce et épouse le duc de Gloucester Humphrey, frère du duc de Bedford. Le pape casse ce mariage. Elle retourne dans ses terres, mais elle est faite prisonnière et remise aux mains du duc de Bourgogne. Elle est obligée de reconnaître son cousin Philippe comme l’héritier de ses quatre comtés. En 1429, Philippe rachète pour 132 000 écus le comté de Namur à son dernier seigneur. 1429, c’est l’arrivée de Jeanne d'Arc sur la scène de l’Histoire de France. Le 8 mars, elle se présente à Charles VII à Chinon et lui annonce qu’elle va lever le siège d'Orléans et le faire couronner à Reims. Le 8 mai, après quatre jours de combats, les Anglais lèvent le siège d'Orléans, battus par les troupes françaises conduites par Jeanne d’Arc. Le 17 juillet, Charles est couronné dans la cathédrale de Reims, après que l’armée de Jeanne eue traversé les villes de Gien, d'Auxerre, de Saint-Florentin et de Troyes sur son passage. À la mort de ses deux cousins Jean (1427) et Philippe (1430), les deux fils de son oncle Antoine, Philippe le Bon hérite des duchés de Brabant et de Limbourg. 10 janvier 1430, Philippe épouse à Bruges en troisième noce Isabelle, la fille du roi du Portugal Jean Ier. Il profite de cette cérémonie pour créer l’ordre de la Toison d'Or qui sert au duc comte de montrer sa puissance en récompensant ses fidèles serviteurs. Le 23 mai, les troupes bourguignonnes capturent Jeanne d'Arc à Compiègne et la livrent aux Anglais. En mai, le duc de Bourgogne se décide à mener une guerre totale contre le Dauphin. Il laisse son vassal, le prince d'Orange, Louis de Chalon-Arlay se lancer à la conquête du Dauphiné. Louis est intéressé à titre personnel, car il souhaite réunir ses terres de sa principauté avec ses domaines dans le comté de Bourgogne. Le 11 juin, les troupes de Louis se heurtent aux troupes dauphinoises à Anthon, ces dernières moins nombreuses, mais plus motivées et connaissant parfaitement la région, mettent en pièce leurs agresseurs. La conquête du Dauphiné est abandonnée. Les Bourguignons sont plus chanceux dans le conflit qui les opposent aux Lorrains. Philippe se mêle de la guerre de succession sur le duché de Lorraine en choisissant le parti de Antoine de Vaudémont contre celui de René d’Anjou. Le 2 juillet 1431, les troupes bourguignonnes conduites par le maréchal Jean de Vergy battent celles du duc René et capturent celui-ci ainsi que de nombreux chevaliers. René est emmené en captivité à Dijon puis à Salins et reste six ans dans les geôles bourguignonnes avant de retrouver la liberté en contrepartie de la livraison de quatre châteaux à Philippe le Bon. En représailles de cette captivité, les troupes du duc Louis III d'Anjou, frère du duc René, envahissent la principauté d'Orange et restent en place jusqu’à la libération du captif. La rupture anglo-bourguignonne À partir de 1431, Philippe commence de s’éloigner de plus en plus des Anglais. La même année, Jeanne d'Arc est condamnée à mort et brûlée vive. En 1432, un complot contre le duc de Bourgogne est découvert, parmi les conspirateurs Jean de la Trémoille, grand chambellan. Les traites se réfugient à la cour de France, commanditaire de ces agissements. La même année, Les Armagnacs s’emparent de nouveau de la forteresse de Solutré qui garde Mâcon. Une bande favorable à Charles VII s’empare d'Avallon en décembre. En 1433, le duc de Bedford épouse la fille du Comte de Saint-Pol, vassal de Philippe, sans lui demander son aval, cela provoque une distension encore plus grande entre Bourguignons et Anglais. Philippe vient libérer en octobre Avallon. En 1434, le duc de Bourbon, allié du roi de France, envahit la Bourgogne, Philippe se met en route avec son armée et attaque à son tour les états du duc de Bourbon. La médiation du duc de Savoie arrête le conflit. Dans l’acte signé par les deux parties, Philippe obtient la destruction totale de la forteresse de la Roche de Solutré. Les Mâconnais éprouvent une grande joie à cette nouvelle et participent au démantèlement. Les grands-ducs d’Occident En 1435, au congrès d'Arras, Philippe le Bon fait la paix avec le roi de France Charles VII, il obtient les comtés de Mâcon, d'Auxerre et les villes de la Somme, mais également l’exemption de toute vassalité sa vie durant et se rend donc totalement indépendant du roi de France. Philippe III se fait appeler grand-duc d’Occident. En 1436, Philippe déclare la guerre à l’Angleterre : la guerre civile est terminée. Les soldats licenciés sur place après le congrès d'Arras, se constituent en bandes, les «Écorcheurs». Ils pillent Dole en 1437, Montbéliard en 1439. On voit même des seigneurs locaux se conduirent comme les dignes rivaux de ces bandes et ravagent à leur tour la Bourgogne. Pendant ces deux années, la Bourgogne ducale et comtale est touchée par la famine, ce qui accentue le malheur des paysans. En 1440, le duc de Bourgogne négocie avec les Anglais la libération du duc d'Orléans prisonnier depuis vingt-cinq ans. Il verse la somme de 120 000 écus, et Charles Ier rejoint ses terres d’Orléans. En octobre 1442, Philippe le Bon rencontre l’empereur Frédéric III de Habsbourg à Besançon. Le duc, l’archevêque et la Commune en profitent pour faire confirmer leurs droits respectifs mais sans aucun changement sur leurs désaccords. En 1443, la duchesse de Luxembourg Élisabeth de Gorlitz, la tante de Philippe, puisqu’elle est la veuve de Antoine de Brabant, vient trouver son neveu, car les troupes du duc de Saxe envahissent son duché. Philippe accepte d’aider la duchesse et se fait remettre par un accord le duché, et en deux mois ses troupes récupèrent les terres luxembourgeoises. L’empire bourguignon s’étend tout à la fois au nord et au sud de ses limites, il devient une menace pour la France. En 1444, le reste des « Écorcheurs » revenant de Suisse où ils avaient été emmenés par le dauphin Louis, à la demande de l’empereur Frédéric III, ravagent Lure, Luxeuil, Faucogney, Faverney et la campagne dijonnaise. Ils n’ont ni foi, ni loi, et leurs actions font de nombreuses victimes. Les nobles comtois lèvent une armée qui sous le commandement du maréchal de Bourgogne, Thiébaud de Neufchâtel, en extermine une moitié à Altkirch en 1445. Mais ces bandits soutenus secrètement par le roi de France continuent leurs terribles méfaits, en pillant, brûlant et tuant tout sur leur passage. Une seconde armée et l’argent mirent fin à leur existence. En 1451, à la mort de Jean de la Trémoille, quittant ce monde sans enfant, le duc prend sa revanche sur ce traite et confisque sa seigneurie de Jonvelle et l’incorpore à ses terres. En 1456, le dauphin Louis le futur Louis XI fâché avec son père se réfugie chez le duc de Bourgogne qui l’installe dans le Brabant. Il reste là-bas jusqu’à la mort de son père. C’est Philippe qui couronne Louis XI à Reims en août 1461. La reconnaissance est un sentiment inconnu à Louis, il oublie cette terre de Bourgogne qui lui a été si hospitalière, et il cherche à affaiblir le duc de Bourgogne. Il commence par brouiller le fils Charles, comte de Charolais avec son père; Charles qui a été pendant cinq ans son ami et son compagnon de jeu. À l’issue du couronnement de Louis, Charles décide d’aller visiter ses terres bourguignonnes, le 11 octobre, il entre dans Dijon, puis va en pèlerinage à Saint-Claude, sur le trajet, il s’arrête au Mont Roland, près de Dole, puis à Nozeroy chez le Prince d’Orange, Louis de Chalon. Charles gagne ensuite Moulins pour rencontrer sa tante et belle-mère, la duchesse de Bourbon. On le voit ensuite à Nevers auprès de son cousin Charles de Nevers. Le roi réclame sa présence à Tours, et Charles s’y rend le 22 novembre. Puis il regagne ses terres de Flandres, et retrouve son épouse et ses parents. En 1463, Louis XI rachète à Philippe pour 400 000 écus les villes de la Somme (Amiens, Abbeville et Saint-Quentin). Charles se sent spolié et fait des reproches à son père. En 1465, le comte de Charolais annonce qu’il prend la tête de la ligue des princes français (les ducs de Berry, de Bourbon, de Bretagne, de Calabre, de Nemours et les comtes d'Armagnac, de Dunois, de Saint-Pol) contre le roi de France. Le conflit entre Louis XI et Charles le Téméraire Le 16 juillet 1465, les deux armées (celle du roi et celle des ligueurs) se rencontrent à Montlhéry, le résultat reste incertain, même si la victoire des ligueurs est pratiquement avérée. Le 19 août, les troupes de Charles, des ducs de Bretagne, de Berry et de Calabre, du Maréchal de Bourgogne viennent faire le siège de Paris. Mais la ville est trop grande, et le siège n’en n’est pas un. Le 26 septembre Isabelle de Bourbon seconde épouse de Charles le Téméraire décède. Charles est très affecté, car il aimait beaucoup sa femme. Le 3 octobre, Charles de Nevers, allié du roi, est fait prisonnier par les troupes de Charles, et enfermé à Béthune. Le même jour, Charles rencontre une nouvelle fois le roi pour trouver une solution. Louis XI change de politique et entame des négociations. Au traité de Conflans, les chefs de la ligue sont récompensés. Louis inféode le duché de Normandie à son frère le duc de Berry, restitue les villes de la Somme et le comté de Boulogne au comte de Charolais, et Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, est élevé à la dignité de connétable de France. Philippe le Bon meurt à Bruges en 1467. Charles le Téméraire (1467-1477) succède à son père et s’efforce d’agrandir son territoire. Le 2 juillet 1468, Charles épouse en troisième noce, Marguerite d'York, la sœur du roi d'Angleterre Édouard IV, à Bruges avec la magnificence de la cour de Bourgogne. Les fêtes se prolongent pendant dix jours. Louis XI continue ses duperies et lance ses troupes le 15 juillet, contre le duc de Bretagne, l’allié du Téméraire. Ce dernier n’ayant pas de troupes disponibles ne peut aider son ami. C’est seulement un mois plus tard que les troupes royales et bourguignonnes se vont face sur la frontière de la Somme. Charles s’installe à Péronne, et les négociations commencent. Une trêve de six mois est signée. Une rencontre est décidée entre Louis et Charles à Péronne, le 5 octobre, le Téméraire établit une lettre de sauf-conduit pour le roi. Mais dans le même temps, Louis demande au Liégeois de se révolter contre le duc de Bourgogne. Charles apprend la nouvelle et furieux retient Louis prisonnier et l’oblige à aller mettre le siège devant Liège. Quelle ne fut pas la surprise des liégeois en voyant arriver en ennemi, l’allié à l’origine de leur révolte? Les Liégeois attaquent les premiers, mais l’assaut donné par les Bourguignons et les Français ne rencontre aucune résistance. La ville est pillée et incendiée et la population périt presque entièrement. Charles le Téméraire
Le 9 mai 1469, l’archiduc d'Autriche Sigismond, cousin-germain de l’empereur Frédéric III, vient solliciter Charles pour un prêt, afin d’acheter la paix auprès des Suisses qui envahissent ses villes du sud de l’Alsace ou Sundgau. En contrepartie de ce prêt, Sigismond engage ses terres du comté de Ferrette, du landgraviat de Haute-alsace, du comté de Hauenstein, et quelques villes rhénanes, à Charles, mais avec une clause de rachat éventuel en une seule fois. Charles lui prête 80 000 florins et espère que l’archiduc ne pourra pas accomplir cette dernière clause. Cet acte n’est pas sans danger sur le plan diplomatique. En s’installant sur les deux rives du Rhin, Charles bloque l’expansion vers le nord des Bernois, ses alliés, mais ces derniers cherchent un appui du côté de Louis XI, mais ce dernier ne donne pas suite. Charles prend possession de ses terres « alsaciennes » et nomme Pierre de Hagenbach, bailli de la Haute-alsace. Ce dernier n’est pas un grand diplomate, il se brouille avec les villes de Mulhouse et de Berne et dans l’été 1470, des incidents de frontière ont lieu entre Suisses et Bourguignons. Les Suisses qui jusqu’à là étaient des alliés du Bourguignon et ennemis des Habsbourg, changent de politique et se rapprochent de Sigismond pour trouver un terrain d’entente. Charles continue d’offrir sa médiation entre l’archiduc et les cantons, mais tout le monde joue un double jeu, et la rupture entre les Suisses et la Bourgogne est proche de la consommation. Pendant ce temps, Louis continue de manigancer contre Charles et réussit à le faire condamner pour lèse-majesté par le Parlement de Paris, en 1471, suite aux événements de Péronne. Il lance ses troupes sur la Picardie, celle-ci se présentent devant Saint-Quentin et Amiens. Le connétable de Saint-Pol s’installe dans Saint-Quentin, le duc comprend que le connétable l’a trahis, et lui confisque ses terres. Puis les troupes royales sous les ordres du comte de Dammartin s’emparent d’Amiens le 02 février. Charles réagit et vient mettre le siège devant Amiens, mais le connétable entre dans la ville le 17 mars, sans intervention des bourguignons. Une trêve est signée pour trois mois, par l’entremise du comte de Saint-Pol. Mais dans le même temps, Louis XI a lancé des troupes sur la Bourgogne. Le 26 février, elles s’attaquent à Mâcon, sans succès, mais deux jours plus tard, elles prennent Cluny et pillent la ville, puis Saint-gengoux, mais échouent devant Tournus. Elles se replient sur le Charolais, et prennent les villes de Charolles, et Paray le monial. Mais le roi ne donne pas suite et met fin aux hostilités, par une trêve le 04 avril. Le 10 juin, une trêve d’un an est reconduite, et le roi restitue les villes bourguignonnes, mais conserve Amiens et Saint-Quentin. Une nouvelle ligue est formée, en janvier 1472, elle est composée des rois d'Angleterre, d'Aragon, des ducs de Guyenne et de Berry, de Bourgogne, de Bretagne, d'Alençon et du comte d’Armagnac. Mai 1472, le destin apporte son concours à Louis XI, son frère Charles duc de Guyenne et de Berry, meurt subitement. Juin 1472, Charles le Téméraire envahit la Picardie, s’empare de Neyles et met le siège devant Beauvais. Mais la résistance des habitants et notamment des femmes, conduite par une simple fille du peuple, Jeanne Laine, surnommée Jeanne Hachette, oblige le duc de Bourgogne à lever le siège. Charles se dirige vers la Normandie et se présente devant Rouen, mais la ville est puissamment défendue, et Charles retourne en Picardie. Novembre 1472, une trêve de cinq mois est signée. Charles profite de cette trêve pour acheter des capitaines « condottiere » italiens, notamment Colleone et le comte de Campobasso. Le 12 janvier 1473, il réunit les États Généraux de ses principautés du nord à Bruges, pour leur demander une importante aide financière, afin de continuer la lutte contre la France. Il obtient 500 000 florins par an et pour six ans. Les principautés du sud sont convoquées en octobre à Dijon, et acceptent de verser 100 000 livres estevenantes par an et pour six ans au duc. La trêve avec le roi est reconduite jusqu’en avril 1474. En juillet 1473, Charles annexe le duché de Gueldre après la mort du duc Arnould, celui-ci ayant déshérité son fils Adolphe, au profit du duc de Bourgogne. Adolphe est enfermé à Courtrai. L’échec à l’empire et au royaume de Bourgogne Dès la fin 1472, Charles envoie des ambassades vers l’empereur Frédéric III, pour lui proposer un marché : sa fille Marie épousera Maximilien, si l’empereur lui attribue la couronne de roi des Romains, de son vivant, afin qu’il puisse devenir empereur à la mort de Frédéric, et ensuite transmettre son titre à son futur gendre. Une rencontre personnelle entre Charles et Frédéric III est prévue à Trèves le 30 septembre 1473. Charles donne à cette entrevue un faste énorme. Les deux hommes s’invitent régulièrement sur tout le mois d’octobre dans leur quartier, mais les bases du marché de Charles n’ont toujours pas d’écho dans le parti adversaire. La maison de Bourgogne au XVème siècle
L’alliance du Rhin contre la Bourgogne Charles vient visiter les terres qu’il a en gage de Sigismond, et parcourt l’Alsace qui est en état de subversion à cause du gouverneur Pierre de Hagenbach, qui fait régner la violence. Du coup, les villes d'Alsace, la Confédération Suisse et les villes du Rhin décident en mars 1473, d’une alliance défensive contre le grand-duc d’Occident. Ce dernier passe les fêtes de fin d’année en Alsace pour affirmer sa détermination de conserver ses terres « alsaciennes ». Ensuite, début janvier, le grand-duc Charles se rend dans son duché et son comté de Bourgogne, c’est la première fois depuis sa prise de pouvoir qu’il revient sur ses terres natales. Il passe par Belfort et Montbéliard, le 14 janvier 1474 il est à Besançon, il y reste trois jours, puis fait une entrée solennelle dans Dijon le 23. Une cérémonie dans l’abbatiale de Saint-Bénigne permet au duc de prendre possession du duché de Bourgogne, en passant à son doigt l’anneau traditionnel. Le 10 février, Charles dirige un magnifique cortège qui transportent les corps de ses parents, Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal, dans la chartreuse de Champmol. Puis le duc va visiter son comté de Bourgogne. Le 21 février, il tient un Parlement à Dole, puis visite les villes d’Arbois, de Salins, de Quingey, de Besançon, de Vesoul et de Luxeuil. Mais pendant ce temps, les villes alsaciennes, la confédération suisse, et l’archiduc Sigismond passent des accords pour éliminer la présence bourguignonne dans leur région, en permettant à l’archiduc de racheter son prêt. Une ligue est formée, le 27 mars, on l’appelle la Basse-Union, elle comprend les villes de Strasbourg, Bâle, Colmar et Sigismond. Le 4 avril c’est l’alliance entre ces mêmes villes et les confédérés suisses, sous l’appellation de ligue de Constance. Ces accords sont défensifs, sauf si Charles refuse le rachat, dans ce cas, Sigismond lui déclarera la guerre. Le 6 avril, Sigismond informe Charles qu’il est en mesure de racheter sa dette; en conséquence il demande la remise de ses terres. Les villes d'Alsace se soulèvent et Pierre de Hagenbach est arrêté. Il est jugé et condamné à mort en mai 1474. Charles est furieux, il organise son armée dans les Deux Bourgognes, mais n’intervient pas en Alsace. Charles s’en prend au comte de Montbéliard, Henri de Wurtemberg, en le faisant arrêter. Il réclame pour sa délivrance son comté. La forteresse de Montbéliard lui apporterait une pièce essentielle dans sa guerre contre les Suisses. À la nouvelle de cet enlèvement, les Bâlois se dirigent vers la cité pour aider à sa défense. Les Bourguignons se présentent au pied de la citadelle, le 2 juin, et menacent de tuer Henri, si elle ne se rend pas. Le gouverneur de la ville ne cède pas. Au bout de quelques jours, les Bourguignons lèvent le siège et libèrent Henri quelques mois plus tard. La tentative de prise de possession du comté de Montbéliard a échoué. Afin de se lancer dans la campagne de reconquête de l’Alsace, Charles décide d’aller aider son allié, l’archevêque de Cologne, Robert de Wittelsbach, en conflit avec certaines villes de sa principauté, et notamment Cologne et Neuss. Le 21 juillet 1474, le grand-duc décide d’assiéger Neuss, le siège commence. L’importance et la splendeur du camp bourguignon frappe ses contemporains. Mais du côté des opérations militaires et malgré l’aide de compagnies Anglaises et Italiennes, les troupes du duc ne parviennent pas à prendre la ville. Le siège dure et le camp des assiégeants devient la capitale des États Bourguignons. Le duc reçoit l’ensemble des ambassadeurs d’Europe, avec faste. Mais pendant ce temps, ses ennemis dans l’empire se préparent à l’attaquer, d’un côté l’empereur et les princes allemands, de l’autre les ligueurs de Basse-Union et de Constance. Le 29 octobre, le duc d'Autriche et les cantons suisses forts du soutien du roi de France, déclarent la guerre à Charles. Dix-huit mille fédérés (Autrichiens, Alsaciens, Suisses) entrent en Franche-Comté et se présentent devant Héricourt, les troupes bourguignonnes sont battues le 13 novembre, et la garnison se rend le 17. En avril 1475, les bernois entrent dans la Comté, et prennent Pontarlier, mais ils doivent abandonner la ville, suite à l’arrivée de troupes bourguignonnes. Mais ils reviennent quelques jours plus tard et reprennent la ville, mais ils doivent de nouveau l’abandonner suite à une nouvelle riposte des bourguignons. Puis les troupes bernoises se lancent dans la conquête du pays de Vaud, terres savoisiennes, et allié du Bourguignon. Fin avril et début mai, les villes de Grandson, d’Orbe et de Jougne tombent dans les mains des suisses. Charles se doit de réagir, car ces villes appartenaient à ses vassaux, Louis de Chalon et Huguenin de Chalon. Pendant ce temps, le siège de Neuss dure et les alliances se renforcent, le duc de Lorraine, René II, rejoint la ligue de Basse-Union et l’empereur. De son côté Charles reçoit le soutien du roi de Naples. Le 23 mai, les troupes impériales sous la conduite de Frédéric III, arrivent aux abords de Neuss. Le 16 juin, une escarmouche oppose des troupes impériales à celles des bourguignons, ces derniers en sortent vainqueur. Fort de cette victoire, Charles en profite pour lever le siège de cette ville, et s’en va le 27 juin, après 11 mois d’un siège inutile. Puis les français lancent des attaques sur le duché et le comté de Bourgogne. Début mai, ils ravagent la Franche-Comté et s’emparent de Jonvelle, de Jussey et de Champlitte, sous la conduite de Georges de la Trémoille, sire de Craon, neveu de l’ancien chambellan, Jean de la Trémoille, celui qui trahit le duc Philippe. Georges se comporte avec brutalité, partout la cruauté est appliquée sur les villes qui capitulent. Le 20 juin, le maréchal de Bourgogne, Antoine de Luxembourg, se fait prendre à Montreuillon, et livré à Louis XI. En juillet se sont les coalisés autrichiens et alsaciens qui attaquent à leur tour le comté de Bourgogne, ils prennent Pont de Roide, Isle sur le Doubs et Blamont. Au mois d’août, les troupes du duc de Bourbon envahissent le Mâconnais. Mais la jonction entre les troupes de Craon et celles des coalisés ne s’effectue pas. Une trêve de neuf ans est signée en septembre 1475 entre le roi Louis et le grand-duc Charles, celle-ci exclut de cet accord, le duc de Lorraine, les Alsaciens et la Basse-Union. Le bourguignon se lance alors à la conquête du duché de Lorraine, et le 30 novembre 1475, il fait son entrée triomphante dans Nancy et se fait reconnaître duc de Lorraine. L’ambition du grand-duc ne peut se satisfaire de cette nouvelle conquête, son désir de vengeance envers les Suisses est le plus fort, et il rêve toujours d’agrandir encore plus ses terres. La fin de la grande Bourgogne Début de l’année 1476, il prépare ses troupes à Nancy, passe par Besançon, et entre en Suisse. Le 23 février, il s’empare de Neuchâtel, puis le 28, du château de Grandson, mais le 2 mars, ses troupes sont défaites par les Suisses et les coalisés de la Basse-Union; au abord de Grandson, le sire de Châtel-Guyon, Louis de Chalon-Arlay, y trouve la mort. Le duc doit abandonner à ses vainqueurs une centaine de pièces d’artillerie et ses richesses (argent, bijoux, tapisseries, vaisselles, vêtements). Il regagne la Franche-Comté et s’installe à Nozeroy. Puis le 14 mars, il installe son camp à Lausanne, et reconstitue ses forces. Le duc rassemble une nouvelle armée et rencontre une nouvelle fois les confédérés (Suisses, Autrichiens, Alsaciens et Lorrains) à Morat. Charles subit une terrible défaite, le 22 juin 1476, où ses troupes sont pratiquement exterminées. On évalue à plus de quinze mille le nombre de soldats morts dans le camp bourguignon, sans parler de la perte de son artillerie. Le duc se retire vers Gex, pour rencontrer Yolande, la duchesse de Savoie, et la convaincre de l’aider. Mais il ne réussit pas dans sa tentative. Il se retire à Salins, via Saint-Claude, Moirans, Poligny et Arbois. Là il rejoint le reste de ses forces. En septembre, il va camper avec son armée, à La Rivière, près de Pontarlier. Le duc de Lorraine exploite la défaite des Bourguignons pour reprendre Nancy en octobre. Charles se présente en décembre devant Nancy, qui résiste pendant six semaines. Mais les renforts arrivent, et de nouveau les coalisés (Suisses, Alsaciens, Autrichiens et Lorrains) défont les troupes bourguignonnes. Charles trouve la mort, le 5 janvier 1477, à l’issue du combat. Le lendemain on retrouve son corps, au bord de l’étang de la Commanderie, transpercé de coup de lance, la tête fendue par une hallebarde jusqu’aux dents, la moitié du visage mangée par les loups. Ainsi périt le dernier duc de Bourgogne. Il laisse son héritage à sa fille Marie qui n’a que vingt ans. Celle-ci apprend à Gand la mort de son père. Les intrigues liées à cette immense succession vont saper la vie de cette princesse. Le corps de Charles est enseveli dans l’église de Saint-Georges de Nancy et fut transporté en 1550 par Charles Quint, son arrière-petit-fils, à Bruges dans un magnifique tombeau. L’annexion française La mort de Charles le Téméraire devant Nancy qu’il assiégeait le 5 janvier 1477, permet à Louis XI de revendiquer le duché et le comté de Bourgogne, au nom de sa filleule Marie de Bourgogne. Il demande au prince d'Orange Jean IV de Chalon-Arlay (1476-1502), d’assurer l’acceptation de cette revendication, par les États des deux provinces, en échange de la promesse du gouvernement des deux Bourgognes. Les États du duché de Bourgogne ainsi que ceux du comté de Bourgogne votent la réunion avec la France, dans l’espoir du mariage du dauphin Charles avec Marie. Une garnison française s’installe à Dole, à Gray, à Marnay et à Salins. Marie qui réside à Gand, convoque les États de Flandre. Ceux-ci établissent un conseil de régence « le Grand Privilège » qui s’empare du gouvernement. Le conseil oblige Marie à envoyer une ambassade au roi de France. Louis reçoit celle-ci et va utiliser toute sa perfidie. Il fait croire aux Flamands, que Marie à un conseil secret composé d’anciens amis de son père opposés aux libertés flamandes. Pour justifier ses dires, il leur remet une lettre de Marie avec les noms des deux complices. Cette lettre est un faux. De retour à Gand, le conseil de régence condamne à mort les deux conseillers. Marie ne peut pas empêcher l’exécution, malgré son intervention au pied de l’échafaud. Marie haït Louis XI et jure de ne point tomber aux mains de ce roi, cause de tous ses malheurs. Louis qui a agit ainsi pour diviser les Flamands, perd pour toujours la confiance de cette princesse. Alors les États de Flandre cherchent un époux à Marie et reprennent les négociations avec l’empereur Germanique commencées sous Charles le Téméraire. Louis XI déclare le défunt duc comme félon et s’empare de ses États. Après avoir conquis la Picardie, il s’empare de l’Artois. Louis tente l’occupation du Hainaut, mais le peuple se révolte et chasse les Français, la conquête est manquée. Marie de Bourgogne
La révolte Dans la Comté, les villes se soulèvent en février 1477 et se déclarent pour Marie. Georges de la Trémoille, sire de Craon, envahit le nord de la Franche-Comté. Rappelons que Georges est ce triste personnage qui ravagea la Franche-Comté en 1474. Dans le duché et le comté de Bourgogne, le prince d’Orange Jean de Chalon, a rejoint la révolte avec l’appui de trois mille Suisses. Au cri de « Vive Mademoiselle », ils reprennent la totalité du comté, sauf Gray, et occupent les villes de Beaune, de Semur en Auxois et de Verdun dans le duché. D’autres villes se soulèvent pour les soutenir, et notamment après l’appel émouvant de Marie aux Bourguignons « Maintenir la foi de Bourgogne », notamment Dijon et Chalon-sur-Saône, ainsi que les nobles du Charolais. Craon est battu partout par les insurgés. Louis XI le relève de son commandement et nomme Charles d’Amboise (1477-1480), seigneur de Chaumont, pour lui succéder. Ce dernier va se conduire avec férocité. Les Français reprennent Chalon et saccagent complètement la ville, ensuite ils incendient totalement la ville de Cuiseaux. Le 18 août 1477, Marie de Bourgogne (1477-1482), la fille de Charles le Téméraire, épouse l’archiduc d’Autriche Maximilien de Habsbourg, le fils de l’empereur Germanique Frédéric III. Avril 1478, une trêve d’une année est signée entre Louis et Maximilien, par laquelle le roi renonce aux comtés de Hainaut et de Bourgogne, mais conserve la Picardie et le duché de Bourgogne. Louis XI passe un traité avec les Suisses et moyennant vingt mille francs, il obtient un corps de six mille Suisses. Ces derniers changent de camp et abandonnent les partisans de Marie, c’est aussi le cas de Hugues de Chalon, sire de Châtelguyon, qui passe dans le camp français. La lutte franco-allemande 1479, Charles d’Amboise entreprend la conquête de la Franche-Comté, il prend Dole, le 25 mai, par traîtrise, et ses troupes massacrent les habitants, la ville est complètement détruite sur ses ordres par un incendie. La résistance héroïque de certains Dolois a donné lieu à la célèbre réplique : « Comtois, rends-toi ! – Nenni, ma foi ! ». Les Suisses et les Français se conduisent avec cruauté partout où ils passent. Salins, Poligny, Arbois, Auxonne, Gray, Luxeuil, Faucogney et Vesoul subissent le même sort que Dole. Amboise se dirige vers Besançon ville d’empire, la ville cède et demande la reconnaissance de sa neutralité; mais Amboise refuse et demande pour le roi, les mêmes droits que le duc de Bourgogne possédait sur la ville. Ils sont accordés. Louis XI se rend à Dijon en juillet 1479, du château de Talant, il voit brûler les villes d’outre Saône. Amboise finit la conquête de la Comté, en s’emparant des derniers lieux de résistance. Louis XI fait détruire la majeure partie des forteresses de Franche-Comté, sauf Joux et Scey-en-Varais, qui sont achetées. Les Deux Bourgognes sont aux mains des Français. Le bilan est désastreux pour la Franche-Comté, Maximilien n’a rien fait pour la secourir. Charles d’Amboise meurt en 1480, il est remplacé par Jean de Baudricourt (1480-1483), qui administre les deux Bourgognes avec sagesse et douceur. Entre 1480/1481, la guerre se déroule maintenant dans les Flandres entre Français et Allemands, toujours aussi cruelle, mais indécise sur son vainqueur. En 1481, l’université de Franche-Comté est transférée de Dole à Besançon. Le 23 mars 1482, Marie meurt des suites d’une chute de cheval, à l’âge de vingt-cinq ans. Maximilien mal aimé de ses sujets Flamands, à cause de ses dépenses énormes et de son refus de faire la paix, mais également parce qu’il est allemand et pas bourguignon, ne peut empêcher les États de Flandre, de Brabant et de Hainaut, de lui soumettre les conditions de la paix avec Louis XI. Le traité d’Arras Le 23 décembre 1482, c’est le traité d’Arras, Marguerite, la fille de Marie et de Maximilien, doit épouser Charles, le fils de Louis XI, et lui apporter en dot, les comtés d'Artois, de Bourgogne, de Mâcon, d'Auxerre, de Charolais et la seigneurie de Salins. Le duché de Bourgogne et la Picardie sont définitivement rattachés à la France. Philippe, le fils de Marie et de Maximilien, hérite du comté de Flandre, fief de la couronne de France, et des duchés de Brabant, de Luxembourg, et des comtés de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Namur, de Frise, fiefs d’empire, et prend alors le titre d’archiduc. Le traité prévoit que si le mariage ne se réalise pas, (en effet, Marguerite a deux ans, et Charles a douze ans), la princesse conserve sa dot. Si elle meurt sans enfant, c’est son frère Philippe qui hérite. Louis XI meurt en août 1483, Charles devient Charles VIII, c’est sa sœur Anne de Beaujeu qui assure la régence. Elle élève également Marguerite qui est à la cour de France depuis le traité d’Arras. En 1484, Dole reprend l’université de Franche-Comté. En 1485, les hostilités éclatent de nouveau entre Français et Allemands dans les Flandres. Les troupes françaises se renforcent dans la Franche-Comté. L’abandon de la Franche-Comté par la France Fin 1490, un mariage par procuration unit Maximilien à la duchesse Anne de Bretagne, Charles VIII ne trouve d’autre parade que d’épouser cette dernière en 1491. La rupture du mariage bourguignon est consommée. Le traité d’Arras est annulé. En 1492, Maximilien lance une expédition militaire pour tenter de reprendre la Franche-Comté aux Français. Au mois de janvier 1493, les troupes comtoises battent les troupes françaises à Dournon (proche de Salins). Les villes de Lure, Faucogney, Jussey et Vesoul sont prises. Besançon est prise à son tour et retrouve son rattachement à l’empire. En mai 1493, Charles VIII tenté par d’autres aventures en Italie, cède la Franche-Comté au traité de Senlis. Charles n’a fait aucun effort pour retenir cette province. Les comtés de Bourgogne, de Charolais, et d'Artois basculent sous l’autorité des Habsbourg, tandis que les comtés de Mâcon, et d'Auxerre basculent sous l’autorité des rois de France. La Saône redevient la frontière entre la France et l’Empire. Marguerite retourne vers son frère Philippe à Gand. La même année, à la mort de son père, Maximilien lui succède dans ses fonctions impériales, mais sans prendre le titre d’empereur. Le duché de Bourgogne Le duché de Bourgogne perd son indépendance pour toujours, incorporé dans le royaume de France en 1482. Cette perte du pouvoir politique n’empêche pas les habitants de cette région de conserver fièrement leur identité bourguignonne. À la tête du duché se trouve le gouverneur, choisi parmi les fidèles du roi. En 1513, Louis XII confie cette charge à Louis de la Trémoille. Dès sa nomination, il doit défendre le duché qui est envahit par les Suisses, et rachète leur départ. Les Guise en seront les titulaires de 1543 à 1595, et la Bourgogne devient pour eux un des foyers des guerres de religion. Pendant trente ans, la Bourgogne souffre et ce n’est qu’après la bataille de Fontaine-Française en 1595 que la province est soumise. Les princes de Condé assurent le gouvernement de la contrée de 1631 à 1789. Le maintien d’un Parlement de Bourgogne à Dijon jusqu’à la Révolution Française, permet de traiter les affaires de cette région. Ce Parlement détient le rôle judiciaire et politique. À noter que le Parlement de Dijon ne contrôle pas totalement le duché. Il reste des États Particuliers à Auxerre, Mâcon, Auxonne et Charolles, qui votent les impôts pour l’administration de leurs terres. Ils seront absorbés les uns après les autres, ceux d'Auxonne en 1639, Auxerre en 1668, Charolles en 1751, sauf ceux de Mâcon. Ces États seront supprimés en juillet 1790, remplacés par les départements qui sont créés par la Révolution Française. Le Nivernais Lors de son avènement au duché de Bourgogne en 1404, Jean sans Peur cède le comté de Nevers à son frère Philippe. À la mort de ce dernier en 1415, le comté passe aux mains de son fils aîné Charles. En 1464, Jean II, frère cadet de Charles hérite du comté, mais il meurt sans héritier mâle. En 1455, Élisabeth, fille et héritière de Jean II, épouse le duc de Clèves Jean Ier. Jean n’est pas étranger à la Bourgogne, sa mère est Marie de Bourgogne, fille du duc Jean sans Peur. Engilbert de Clèves, fils d’Élisabeth et de Jean Ier, hérite du comté de son grand-père maternel en 1491. En 1499, il est nommé gouverneur de la Bourgogne, fonction qu’il exerce jusqu’à sa mort en 1506. Charles de Clèves succède à son père et épouse en 1504 Marie de Rethel, héritière du comté de Rethel. On se rappelle que les deux comtés étaient déjà dans les mêmes mains du XIIIème au XIVème siècle. En 1538, le roi de France François Ier, érige les comtés de Nevers et de Rethel en duchés-pairies pour François de Clèves, fils de Charles et de Marie. François devient pair de France. Henriette de Clèves, fille et héritière du duc François épouse Louis de Gonzague en 1565. Louis est le fils cadet du duc Frédéric II de Mantoue. Le duché passe dans la famille italienne des Gonzague. Vers 1575, Louis de Gonzague introduit la faïence à Nevers. Son fils Charles Ier lui succède en 1595. Le palais des ducs de Nevers
Alors que Charles de Gonzague a pris le pouvoir à Mantoue sans attendre l'investiture impériale dès mars 1628; l'empereur Ferdinand II, sur les instances de la Savoie et de l'Espagne, prononce le séquestre de l'héritage. Gonzague en appelle au roi de France. Richelieu persuade le roi Louis XIII de lancer une intervention sur Mantoue. De 1629 à 1630, la guerre éclate entre la France contre l'Espagne, l'Empire et la Savoie. En octobre 1630, Mazarin obtient l'aval des belligérants sur un accord réglant la succession de Mantoue. En avril 1631, les droits du duc de Nevers sont reconnus sur Mantoue et Montferrat par l’empereur. La même année Charles perd son second fils Charles II, duc de Mayenne et de Rethel. Charles III de Gonzague hérite des duchés de son grand-père et de son père. En 1659, Charles III de Gonzague vend ses duchés de Nevers et de Rethel à Mazarin, Premier ministre du roi de France. Charles conserve ses duchés de Mantoue et de Montferrat. Son fils Ferdinand-Charles lui succède sur les deux duchés italiens, il meurt sans héritier et les duchés sont partagés entre la Savoie et l’Autriche. Mazarin donne le duché à son neveu Philippe Julien Mancini, le fils de sa sœur Girolama. Après la mort de Mazarin, Louis XIV annexe le duché en 1669. Philippe Julien soutient et manifeste ses sympathies pour la littérature et notamment Corneille et Fénelon, il meurt en 1707. Son petit-fils Louis Jules Mancini porte le titre de duc de Nivernais, jusqu’à la Révolution Française de 1789. Il mène une carrière d’homme de lettre et de diplomate. Il est ambassadeur à Rome en 1748, à Berlin en 1756 et à Londres en 1763. Il entre à l’Académie Française en 1742. Il est emprisonné sous la Terreur. Le Tonnerrois À la mort de Marguerite de Chalon-Auxerre, le comté passe aux mains de son fils Jean de Husson (1463-1476). Ses descendants conservent le comté jusqu’en 1537, ensuite il passe dans la famille des Clermont lors du mariage d'Anne de Husson avec Bernard de Clermont. Leurs descendants conservent le titre jusqu’en 1684, date à laquelle Joseph de Clermont-Tonnerre le vend à Louvois, ministre de Louis XIV. Ce qui n’empêche cette famille de conserver le patronymique de Tonnerre dans leur nom jusqu’à nos jours. Le Charolais Au traité de Senlis de 1493, le comté de Charolais est accordé aux Habsbourg comme fief personnel, ceci sous le prétexte que le duc Philippe le Hardi avait acquis cette terre avec la dot de sa belle-fille Marguerite de Bavière. Le titre de comte de Charolais est porté par les descendants de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne, en même temps que le titre de comte de Bourgogne. Pendant les guerres du XVIème et XVIIème entre la France et les Habsbourg, il est occupé tour à tour soit par les Français, soit par les Impériaux, soit par les Espagnols. Sur le plan administratif, il est soumis au régime français, mais sur le plan judiciaire, il appartient au comte d’en assurer le fonctionnement. Il en résulte de nombreuses oppositions sur la compétence des uns et des autres. Lors de la prise de la Franche-Comté par les Français, le traité de Nimègue en 1678, maintient l’appartenance du comté aux Habsbourg d’Espagne. En 1684, Louis II, le prince de Condé, gouverneur de la Bourgogne, le rachète à Charles II d’Espagne. Un Parlement assure alors le fonctionnement du comté. En 1751, le Parlement Particulier du Charolais est absorbé par le Parlement de Bourgogne. À la Révolution Française en 1790, le Charolais est incorporé dans le département de la Saône-et-Loire, et Charolles devient une sous-préfecture. Cette page vous plait, vous pouvez la tweeter Tweet | ||
|
© gilles maillet |
11/11/2024 |